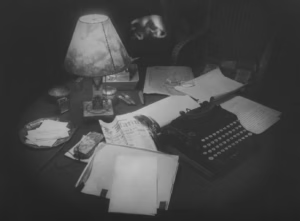L’éthique dans la recherche qualitative est essentielle pour protéger les participants et garantir l’intégrité de l’étude. Les chercheurs doivent adopter des pratiques telles que le consentement éclairé, la confidentialité et la réflexivité, en respectant l’autonomie des participants et en minimisant les risques.

Introduction
L’éthique de la recherche est un sujet fréquemment débattu car elle constitue l’un des piliers fondamentaux qui soutiennent l’intégrité de la science. La recherche qualitative se distingue par sa capacité à explorer la profondeur des expériences humaines, mais cette profondeur implique une responsabilité éthique importante. Selon une étude de l’American Psychological Association (APA, 2017), le manque de pratiques éthiques dans la recherche peut entraîner des conséquences néfastes, non seulement pour les participants, mais aussi pour la crédibilité de la recherche elle-même. Il est donc impératif que les chercheurs adoptent des critères éthiques à toutes les étapes de leurs recherches.
Dans cet article, nous aborderons les principes éthiques et les stratégies pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour assurer la protection des participants et l’intégrité de l’étude.
Concepts et définitions de l'éthique dans la recherche qualitative
L'éthique dans la recherche qualitative
L’éthique dans la recherche qualitative fait référence à l’ensemble des principes qui guident la conduite des études, garantissant la protection des participants et l’intégrité du processus de recherche. Cela inclut la prise en compte de questions telles que le consentement éclairé, la confidentialité et la réflexivité (Liamputtong, 2007).
Consentement éclairé
Le consentement éclairé est un processus par lequel les participants sont informés des objectifs, des méthodes, des risques et des avantages de la recherche, leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant leur participation. Ce processus doit être considéré comme un dialogue permanent entre le chercheur et le participant. La clarté et la transparence sont essentielles pour garantir que les participants comprennent pleinement ce qui est en jeu (Beauchamp et Childress, 2013). Par exemple, lorsqu’ils mènent des recherches sur la santé mentale, les chercheurs devraient expliquer clairement les risques potentiels liés à la discussion d’expériences personnelles.
À son tour, il est essentiel de connaître les aspects que le consentement éclairé adopte pour les mineurs, qu’ils soient enfants et/ou adolescents. En particulier, l'autorisation dépend du représentant légal du participant, malgré cela, le mineur peut décider de participer ou non, s'il a préalablement obtenu le consentement de l'adulte. D'autre part, le chercheur doit être au courant de la réglementation de son pays, car, par exemple, dans certains pays, les adolescents de 16 ans et plus peuvent donner leur consentement, alors que dans un autre pays, c'est à partir de 18 ans.
Réflexivité
LE réflexivité Il s’agit de l’auto-analyse critique du chercheur sur son rôle et son impact sur le processus de recherche. Il s’agit de prendre conscience de la manière dont les propres croyances, valeurs et expériences du chercheur peuvent influencer la collecte et l’interprétation des données (Finlay, 2002). La réflexivité enrichit l’analyse et contribue à atténuer les biais qui peuvent affecter la recherche. Par exemple, tenir un journal de recherche dans lequel les chercheurs consignent leurs réflexions peut être une pratique précieuse.
Principes éthiques fondamentaux
1. Respect de l'autonomie
Les chercheurs doivent respecter l’autonomie des participants, en veillant à ce qu’ils aient le droit de décider s’ils souhaitent ou non participer à la recherche. Il s’agit de fournir des informations claires et accessibles sur l’étude (Beauchamp & Childress, 2013).
2. Bienfaisance et non-malfaisance
Les chercheurs ont l’obligation de maximiser les avantages et de minimiser les préjudices potentiels pour les participants. Cela nécessite une évaluation minutieuse des risques associés à la recherche et la mise en œuvre de mesures pour les atténuer (Liamputtong, 2007). L’évaluation des risques doit être un processus continu, s’adaptant à mesure que de nouvelles informations émergent au cours de la recherche.
3. Justice
La justice dans la recherche implique de veiller à ce que les avantages et les inconvénients de la recherche soient répartis équitablement entre tous les groupes sociaux. Il s’agit d’éviter l’exploitation des populations vulnérables et de garantir que tous les groupes ont un accès égal aux bénéfices de la recherche (Vidal, 2022).
Assurer la confidentialité des participants
La confidentialité est un aspect crucial de l’éthique dans la recherche qualitative. Les chercheurs doivent mettre en œuvre des stratégies pour protéger l’identité et les données des participants. Voici quelques bonnes pratiques :
- Codage des données ou pseudonymes : Attribuer des codes aux données collectées, au lieu d’utiliser des noms ou des identifiants personnels, pour protéger l’identité des participants ou utiliser également des noms fictifs (Liamputtong, 2007).
- Stockage sécurisé:Utilisez des méthodes sécurisées pour stocker les données, telles que le cryptage et l’accès restreint, afin d’éviter les fuites d’informations (Grande Ratti et al., 2024).
- Consentement à la divulgation:Obtenir le consentement des participants avant de partager toute information qui pourrait les identifier, même dans des publications ou des présentations (Beauchamp et Childress, 2013).
Réflexivité dans la recherche qualitative
La réflexivité est une pratique essentielle qui permet aux chercheurs de reconnaître et de réfléchir à leurs propres influences dans le processus de recherche. Cela peut inclure :
- Journaux de recherche:Tenir un journal de recherche dans lequel les chercheurs enregistrent leurs réflexions sur le processus, leurs interactions avec les participants et leurs propres réactions émotionnelles (Finlay, 2002).
- Discussions de groupe:Participer à des groupes de discussion avec d’autres chercheurs pour partager des expériences et des réflexions sur des questions éthiques et méthodologiques.
- Supervision et mentorat:Demandez conseil à des collègues plus expérimentés pour discuter des dilemmes éthiques et recevoir des commentaires sur l’approche de recherche (Liamputtong, 2007).
Conséquences du manque d'éthique dans la recherche qualitative
Le manque d’éthique dans la recherche qualitative peut avoir de graves conséquences, tant pour les participants que pour la communauté scientifique. Certaines des implications incluent :
- Dommages aux participants:La recherche non éthique peut causer des dommages physiques, émotionnels ou psychologiques aux participants, compromettant leur sécurité et leur bien-être (Faculté des sciences pharmaceutiques de Ribeirão Preto, Université de São Paulo [FCFRP-USP], 2020).
- Méfiance envers la recherche:Les scandales de recherche peuvent entraîner une méfiance généralisée au sein de la communauté scientifique, rendant difficile l’acceptation de nouvelles études et découvertes (Pinto, 2015).
- Conséquences juridiques:Les chercheurs qui ne respectent pas les directives éthiques peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires, notamment de poursuites judiciaires et de sanctions professionnelles.
Questions fréquemment posées et erreurs sur l'éthique dans la recherche qualitative
Confusion entre éthique et conformité
Une erreur courante chez les chercheurs est de confondre éthique et conformité. Beaucoup pensent que l’approbation d’un comité d’éthique suffit à garantir l’éthique de la recherche. Cependant, l’éthique doit être considérée comme un processus continu qui implique réflexion et adaptation tout au long de l’étude (Beauchamp et Childress, 2013).
Sous-estimer l'importance du consentement éclairé
Une autre erreur courante consiste à ne pas fournir suffisamment d’informations aux participants au cours du processus de consentement éclairé. Cela peut compromettre la validité du consentement et l’intégrité de la recherche. Les chercheurs doivent s’assurer que les participants comprennent pleinement ce qui est en jeu avant d’accepter de participer (Padilha et al., 2005).
Implications futures de l'éthique dans la recherche et l'utilisation des technologies
À mesure que la recherche qualitative continue d’évoluer, les lignes directrices éthiques doivent également s’adapter. L’intégration de technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et l’analyse de données massives pose de nouveaux défis éthiques qui nécessitent une approche proactive. Les chercheurs doivent être prêts à prendre en compte des questions telles que la confidentialité des données, le consentement dans les environnements numériques et la responsabilité sociale de leurs recherches (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture [UNESCO], 2021).
Conseils sur les bonnes pratiques de recherche
- Cherchez des conseils:Demandez toujours conseil à des collègues expérimentés lorsque vous êtes confronté à des dilemmes éthiques. L’échange d’expériences peut offrir de nouvelles perspectives et solutions (Finlay, 2002).
- Maintenir la communication ouverte:Établir une communication claire et continue avec les participants sur l’utilisation de leurs données et leur droit de se retirer de la recherche à tout moment. De plus, en ce qui concerne les outils de collecte de données, tels que les enregistrements vocaux, les notes écrites et/ou les vidéos, il est important de convenir de ces procédures avec les participants (Grande Ratti et al., 2024).
- Consultez régulièrement les directives éthiques:Soyez toujours au courant des directives éthiques et des meilleures pratiques dans votre domaine de recherche (FCFRP-USP, 2020).
Conclusion
Une recherche qualitative éthique et responsable est essentielle pour garantir la protection des participants et la crédibilité des résultats. Les chercheurs doivent adopter une approche réflexive et proactive des questions éthiques, en veillant à ce que leurs pratiques soient non seulement conformes aux exigences légales, mais favorisent également le bien-être et la dignité des personnes concernées. En suivant les bonnes pratiques évoquées dans cet article, les chercheurs peuvent contribuer à un domaine d’études plus éthique et engagé envers les différentes problématiques de recherche.
Appel à l'action
Nous vous invitons à partager vos expériences et opinions sur l’éthique dans la recherche qualitative. Comment abordez-vous les questions éthiques dans vos études ? Explorez également la plateforme requalifier.ai, qui propose des outils et des ressources pour aider les chercheurs à mettre en œuvre de bonnes pratiques éthiques dans leurs recherches. Ensemble, nous pouvons promouvoir une recherche plus éthique et responsable.
Glossaire des termes
- Réflexivité:La pratique de l’auto-analyse critique par le chercheur concernant son rôle et son impact sur le processus de recherche.
- Bienfaisance:Le principe éthique qui implique de maximiser les avantages et de minimiser les dommages pour les participants.
Références
Association américaine de psychologie. (2017). Principes éthiques des psychologues et code de conduite. https://www.apa.org/ethics/code/
Beauchamp, T. L., et Childress, J. F. (2013). Principes de l'éthique biomédicale. Presses de l'Université d'Oxford.
Faculté des Sciences Pharmaceutiques de Ribeirão Preto, Université de São Paulo (2020). Lignes directrices pour la promotion des bonnes pratiques scientifiques. Éthique et intégrité dans les activités scientifiques. https://fcfrp.usp.br/wp-content/uploads/sites/528/2020/12/Boas-Pr%C3%A1ticas-Cient%C3%ADficas-da-FCFRP.pdf
Finlay, L. (2002). « Outing » du chercheur : provenance, processus et pratique de la réflexivité. Recherche qualitative en santé, 12(4), 531–545. https://doi.org/10.1177/104973202129120052
Grande Ratti, MF, Murature, D., Sánchez del Roscio, A., Frei, S. et Benítez, SE (2024). L'éthique dans la recherche qualitative. Rév. Hosp. Italien B. Aires. 44(1):e0000295. https://ojs.hospitalitaliano.org.ar/index.php/revistahi/article/view/295/266
Liamputtong, P. (2007). Recherche sur les personnes vulnérables : un guide des méthodes de recherche sensibles. Publications SAGE. https://doi.org/10.4135/9781849209861
Padilha, MICS, Ramos, FRS, Borenstein, MS et Martins, CR (2005). La responsabilité du chercheur ou ce que nous disons de l'éthique de la recherche. Contexte du texte Soins infirmiers. 14(1):96-105. https://www.scielo.br/j/tce/a/JmGdS5LFhF5DzSLSWgZpRGL/?lang=pt#
Pinto, P. T. (2015). Les erreurs éthiques en science : ce qu’elles sont, pourquoi elles se produisent et comment les éviter. Natura neotropicalis 46(2): 33-38. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/71482/CONICET_Digital_Nro.3787d51d-1468-471d-af46-2be00a727666_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (2021). Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics
Vidal, E. A. (2022). Application du principe bioéthique de justice dans l’enquête. Contributions depuis
le principe de solidarité et le concept de responsabilité sociale. UCA – Vie et éthique, 2: 113-129. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/16456/1/aplicaci%C3%B3n-principio-bio%C3%A9tico-justicia.pdf