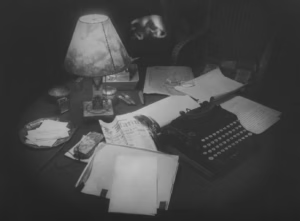Résumé: Le consentement éclairé est un pilier essentiel de la recherche impliquant des participants humains. Il garantit que chaque volontaire comprenne parfaitement les objectifs, les méthodes, les risques et les bénéfices avant d'autoriser sa participation (Grady et al., 2017). Au Brésil, des réglementations telles que la résolution CNS 466/12 et la loi générale sur la protection des données (LGPD) rendent d'autant plus urgente l'adoption de processus de consentement clairs et éthiques. Ce guide offre un aperçu détaillé des principes du consentement éclairé, présentant les questions les plus fréquentes, les erreurs fréquentes et les bonnes pratiques à adopter en recherche qualitative, y compris celles utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des outils tels que requalifier.ai, Nvivo, Atlas.ti, MaxQDA, Iramuteq et d'autres options logiciel d'analyse de données qualitatives.
Introduction
Dans quelle mesure la liberté et la protection des participants doivent-elles être au cœur de la recherche ? Ce débat traverse une grande partie de l'histoire des sciences et s'intensifie après des cas notoires de violations des droits mettant en évidence l'absence de consentement ou le manque de clarté quant aux risques. Pour protéger les volontaires et légitimer les découvertes scientifiques, consentement éclairé est devenue la pierre angulaire de l’éthique de la recherche (Xu et al., 2020).
Dans ce texte, vous trouverez non seulement la définition formelle du consentement éclairé, mais aussi des conseils pratiques pour l'appliquer correctement dans vos études, en tenant compte des aspects culturels, linguistiques, juridiques et technologiques. Nous aborderons également le rôle des comités d'éthique, l'importance des plateformes sécurisées et la manière dont l'adoption de bonnes pratiques renforce la qualité des résultats obtenus. À la fin de ce texte, nous espérons que vous serez en mesure de mener des recherches de manière plus transparente et respectueuse, quelle que soit la méthode ou la technologie utilisée.
Concepts et définitions
Qu’est-ce que le consentement éclairé ?
Le consentement éclairé est un processus éthique et légal par lequel les participants reçoivent, de manière claire et accessible, des informations sur les objectifs, les procédures, les risques et les bénéfices d'une étude de recherche (Riden et al., 2012). Le principe fondamental est le suivant : volontariat:chaque individu a le droit d’accepter ou de refuser sa participation sans subir de pressions ou de représailles.
Les éléments de base qui constituent le consentement éclairé comprennent :
- Objectifs de la recherche : Brève description de ce que vous avez l’intention d’étudier.
- Méthodes utilisées : Détails des étapes et des ressources utilisées, telles que les entretiens, les questionnaires ou l’analyse de contenu.
- Risques et avantages : Explication de ce qui peut être indésirable et de ce qui est attendu comme contribution au participant ou à la science.
- Droits et garanties : La sécurité que le participant peut se retirer à tout moment et que ses données seront traitées de manière confidentielle.
Transparence
Dans la recherche qualitative, le transparence Il est essentiel que les participants aient confiance dans les résultats et participent consciemment. Cela implique d'expliquer clairement chaque étape de la recherche et la destination finale des données collectées (Frost et al., 2021). Dans les études impliquant recherche qualitative avec IA, par exemple, il est essentiel de détailler comment les algorithmes, les processus codification et des outils d'analyse (tels que requalifier.ai ou Iramuteq) seront appliquées, garantissant que l’utilisation de l’intelligence artificielle ne présente pas de risque pour la vie privée.
Confidentialité et confidentialité
Assurer la confidentialité des données signifie garantir que les informations personnelles ne sont pas divulguées de manière inappropriée. analyse de données qualitatives, en particulier ceux qui utilisent des logiciels tels que Nvivo, Atlas.ti, MaxQDA ou requalifier.aiDes protocoles de sécurité appropriés doivent être adoptés. Des protections telles que le chiffrement, les autorisations d'accès et le stockage sécurisé sont des exemples de mesures de protection recommandées, toujours conformes à la LGPD.
Langage accessible
Les chercheurs utilisent parfois un vocabulaire trop technique, ce qui rend la compréhension difficile pour les participants. Pour respecter le consentement éclairé, il est essentiel de rédiger les termes et les formulaires dans un langage simple, en utilisant des exemples concrets et en évitant le jargon (Gelinas et al., 2016). Au Brésil, pays d'une grande diversité culturelle et linguistique, cela peut impliquer d'adapter la langue au contexte régional ou de traduire les documents dans les langues locales, y compris en libra si nécessaire.
Questions importantes sur le consentement éclairé
Quelles informations doivent être incluses dans le formulaire de consentement ?
Principalement, le formulaire de consentement doit inclure les sections suivantes (Riden et al., 2012) :
- Objectifs : Expliquez clairement le problème ou l’hypothèse qui a motivé la recherche.
- Procédures : Décrivez comment la collecte et l’analyse des données seront effectuées, y compris s’il y aura analyse de contenu, recherche qualitative avec IA, etc.
- Risques : Soulignez tout inconfort ou toute implication négative pour le participant.
- Avantages: Expliquez ce qui est attendu en termes d’avancées scientifiques, d’améliorations des pratiques ou de retour social.
- Droits des participants : Expliquez la liberté de refuser, de retirer et de maintenir la confidentialité des données.
- Contacts: Fournissez l'adresse courriel ou le numéro de téléphone du chercheur responsable et du comité d'éthique pour plus de précisions.
Comment s’assurer que les participants comprennent les risques et les avantages ?
La meilleure façon de garantir la compréhension des risques et des avantages est de proposer un espace ouvert aux questions et aux clarifications. Dans les environnements virtuels, vous pouvez utiliser des vidéos explicatives, des formulaires interactifs ou vies réponses rapides aux questions (Hake et al., 2017). Si des modifications sont apportées au protocole, par exemple l'introduction d'une nouvelle méthode codification ou l'adoption d'un autre logiciel d'analyse de données qualitatives —, le chercheur doit rapidement informer les participants et peut même émettre un nouveau formulaire de consentement.
Quels sont les principaux droits des participants ?
Parmi les droits garantis aux participants, les suivants se distinguent (Grady et al., 2017) :
- Droit à l’information : Recevez des explications détaillées sur l'étude.
- Droit à l'autonomie : Choisissez de participer ou non, sans contrainte.
- Droit à la vie privée : Garantir que les données sensibles ne seront pas exposées.
- Droit de révocation : Possibilité de se retirer à tout moment, sans justification.
Comment gérer les spécificités culturelles et linguistiques ?
Dans le contexte brésilien, certaines régions possèdent des langues minoritaires, des expressions culturelles distinctes et des niveaux d'éducation variables. Par conséquent, pour une approche inclusive, nous recommandons la participation des leaders communautaires et des traducteurs à la préparation des documents, afin de garantir une compréhension optimale du contenu (Gelinas et al., 2016). Cette attention s'étend ensuite aux stratégies de communication. analyse de données qualitatives, car la manière d’interpréter les codes et les catégories peut varier selon la culture.
Quelle est la meilleure pratique pour mettre à jour les participants ?
En général, lorsque des changements substantiels surviennent dans la conception de la recherche, tels que l’inclusion de nouvelles sources de données ou méthodes d’analyse (par exemple, l’adoption de requalifier.ai pour la transcription et codification), le chercheur doit immédiatement informer les volontaires (Gelinas et al., 2016). En revanche, si le changement a un impact sur les risques ou les procédures, il est prudent de demander un nouveau consentement, renforçant ainsi l'autonomie des personnes impliquées.
Questions et erreurs fréquentes dans le processus de consentement éclairé
Ambiguïté dans la communication
Certains chercheurs omettent d'expliquer des termes spécifiques, ce qui entraîne une confusion quant aux objectifs ou aux risques. Il est donc important d'éviter toute ambiguïté, ce qui implique de revoir attentivement la forme et de réduire le jargon technique (Gelinas et al., 2016). Si la recherche implique l'IA et analyse de contenu, par exemple, détailler la manière dont les algorithmes identifient les modèles peut être crucial pour la compréhension des participants.
Manque de transparence
L'omission de détails sur les risques potentiels ou la réutilisation des données viole le principe d'autonomie. Une transparence totale, même lorsqu'elle met en évidence des scénarios inconfortables, est préférable à l'omission, qui compromet l'intégrité de l'étude (Grady et al., 2017).
Processus standardisés sans adaptation
Les formulaires de consentement « génériques » peuvent ignorer les besoins culturels, régionaux ou spécifiques d'échantillonnage. Les chercheurs doivent être disposés à personnaliser les documents et le processus d'explication pour garantir une participation efficace (Frost et al., 2021).
Formalisme exagéré
Même la signature d'un formulaire de consentement ne garantit pas nécessairement que le participant a réellement compris. Se concentrer trop sur les aspects bureaucratiques sans établir un dialogue ouvert diminue l'efficacité du consentement et peut engendrer de la méfiance parmi les participants (Dickert et al., 2017).
Examen éthique inadéquat
Le fait de ne pas soumettre une recherche à un comité d'éthique, ou de ne solliciter qu'une approbation initiale sans examens périodiques, peut entraîner de graves violations en matière de sécurité et de droits des participants (Xu et al., 2020). Si des questions ou des changements surviennent en cours d'étude, il est essentiel de renouer le dialogue avec le comité d'éthique.
Thèmes clés pour l'élaboration du consentement éclairé
Approche éthique
La recherche éthique repose sur le respect de la dignité humaine, de la vie privée et de l'autonomie (Xu et al., 2020). Par conséquent, ces valeurs devraient guider toutes les étapes, de la définition de la problématique de recherche à l'archivage des données. De plus, en cas d'application de recherche qualitative avec IA, par exemple, le chercheur doit s'assurer que les algorithmes utilisés dans logiciel d'analyse de données qualitatives respecter la vie privée et ne pas discriminer les groupes vulnérables.
Normes et directives internationales et contexte brésilien
Bien que les directives internationales (par exemple, la Déclaration d'Helsinki) constituent des références générales, le Brésil dispose de sa propre réglementation, comme la résolution CNS 466/12, qui encadre la recherche impliquant des êtres humains. Parallèlement, LGPD renforce la protection des données en exigeant un consentement explicite pour la collecte et l'utilisation des renseignements personnels (Gelinas et al., 2016). Ainsi, le chercheur doit concilier ces deux dimensions pour garantir la légalité du projet.
Consentement dans les environnements en ligne
Avec la numérisation croissante, le consentement éclairé s'étend aux plateformes virtuelles. Les recherches utilisant des questionnaires en ligne, des entretiens vidéo ou l'utilisation de requalifier.ai Pour les transcriptions, des ajustements sont nécessaires. Expliquer comment les données seront stockées, pendant combien de temps et qui y aura accès sont des étapes essentielles pour maintenir la transparence (Frost et al., 2021).
Langue et culture
Respecter les différences linguistiques et culturelles implique non seulement de traduire les termes, mais aussi d'adapter les exemples et les illustrations. Ainsi, des cartes mentales, des infographies ou de courtes vidéos peuvent être utilisées pour expliquer des concepts complexes, tels que recherche qualitative avec IALa participation de médiateurs culturels améliore la compréhension et renforce la légitimité de l’étude (Hake et al., 2017).
Rôle des comités d'éthique
Les comités d'éthique jouent un rôle de supervision et d'orientation, en examinant le protocole de recherche afin de prévenir les abus ou les manquements à l'éthique (Xu et al., 2020). Outre l'examen du formulaire de consentement, ils peuvent proposer des ajustements pour garantir que toute communication est adaptée au public cible, y compris les informations sur l'utilisation de l'IA et les aspects de celle-ci. codification ou analyse de contenu.
Contexte historique et pertinence actuelle du consentement éclairé
Évolution historique
Les fondements du consentement éclairé ont été posés après des événements traumatisants, tels que les pratiques médicales condamnées lors des procès de Nuremberg (1947) (Grady et al., 2017). Par la suite, des documents tels que la Déclaration d'Helsinki ont souligné la nécessité de respecter l'autonomie des participants comme condition fondamentale de la légitimité scientifique. Au Brésil, plusieurs affaires et débats ont renforcé l'importance des réglementations nationales.
Pertinence actuelle
Indéniablement, à une époque où la collecte de données est massive — en particulier avec les progrès de recherche qualitative avec IA et les mégadonnées : le consentement éclairé devient encore plus essentiel (Dickert et al., 2017). Les chercheurs doivent être conscients que tout manquement à la protection des données ou à la fourniture d’informations claires peut entraîner des préjudices éthiques, juridiques et scientifiques.
Conséquences futures du consentement éclairé
Évolution des normes éthiques
Le rythme rapide de l'innovation technologique exige une mise à jour constante des directives en matière de consentement. Ainsi, des logiciels tels que requalifier.ai, Nvivo, Atlas.ti, MaxQDA et Iramuteq permettre analyse de données qualitatives à grande échelle, mais soulèvent également des questions sur la confidentialité et l'utilisation secondaire des données (Gelinas et al., 2016). Une évolution continue des normes éthiques est attendue, y compris des solutions pour IA et le big data.
Impact sur la crédibilité de la recherche
Une recherche bien menée, avec des consentements clairs et éthiques, améliore la réputation non seulement du chercheur, mais aussi de l'institution. Par conséquent, la transparence renforce la confiance et peut faciliter l'accès à des populations plus diversifiées, ajoutant ainsi une valeur scientifique (Hake et al., 2017). En bref, ce processus de renforcement de la crédibilité profite particulièrement aux études portant sur analyse de contenu et recherche qualitative, dans lequel la qualité des données dépend d’une interaction fiable entre le chercheur et le participant.
Défis technologiques
En général, les outils d'IA peuvent automatiser le codage et identifier des schémas complexes dans les témoignages, mais la compréhension et le consentement concernant l'utilisation de ces algorithmes doivent être très clairs (Frost et al., 2021). Ainsi, les technologies émergentes telles que la reconnaissance vocale et l'analyse des sentiments peuvent recueillir des données sensibles, d'où l'importance cruciale que les participants comprennent qui y aura accès, pendant combien de temps et comment ces données seront protégées.
Conseils pratiques pour la mise en œuvre du consentement éclairé
Formulaires clairs et accessibles
Tout d'abord, évitez les phrases longues et chargées de jargon. Organisez le texte en sections avec des sous-titres et, si possible, utilisez des visuels pour illustrer les points clés. Cette pratique facilite la compréhension, réduit la confusion et rend le consentement plus participatif.
Séances de clarification
Deuxièmement, organisez des réunions, virtuelles ou en personne, pour expliquer les objectifs, les risques et les avantages. atelier Un bref entretien préalable à la collecte de données peut s'avérer déterminant pour établir une relation de confiance (Dickert et al., 2017). Dans les recherches utilisant logiciel d'analyse de données qualitatives, vous pouvez présenter des captures d'écran ou des enregistrements rapides pour illustrer comment le matériel sera traité.
Adaptation aux contextes en ligne
Les outils de collecte de données en ligne (questionnaires, entretiens par visioconférence, etc.) nécessitent notamment une clarification des règles de protection des données et de traitement des informations. L'utilisation de plateformes ou de logiciels d'IA, tels que requalifier.aiIl est essentiel d'informer sur la manière dont le contenu est chiffré et sur les personnes autorisées à y accéder (Frost et al., 2021). Le participant a le droit de retirer son consentement, et des instructions de contact claires doivent lui être présentées.
Consultation des comités d'éthique
L'examen par des comités d'éthique (p. ex., CEP/CONEP) doit accompagner le processus de recherche, et ne pas se limiter à l'approbation initiale. Par conséquent, signaler toute modification du protocole modifiant les risques, les méthodes ou l'utilisation des données garantit la légalité et le respect des participants (Xu et al., 2020).
Examens périodiques du consentement
Les études à long terme peuvent connaître des modifications de portée, de calendrier ou de méthodes. Si cela implique des impacts sur la vie privée ou de nouveaux risques, il est essentiel de revalider le consentement. Les participants doivent être conscients de leur rôle et de l'utilisation qui sera faite de leurs données (Frost et al., 2021).
Conclusion
Le consentement éclairé n'est pas une simple formalité ; c'est un engagement éthique qui reflète le respect, l'autonomie et la transparence. Au Brésil, des réglementations spécifiques, telles que la résolution CNS 466/12 et la LGPD, exigent un niveau élevé de responsabilité dans le traitement des données personnelles, que la recherche soit menée de manière traditionnelle ou par le biais de la recherche. recherche qualitative avec IA — en utilisant des outils tels que requalifier.ai, Nvivo, Atlas.ti, MaxQDA ou Iramuteq —, le devoir de protéger la vie privée et de communiquer les risques reste inébranlable.
À mesure que la science évolue, les méthodes et les technologies se renouvellent, exigeant des adaptations constantes des pratiques de consentement. Les chercheurs qui investissent dans la clarté, l'accessibilité et un dialogue permanent avec les participants et les comités d'éthique mènent assurément des études plus légitimes, fiables et socialement responsables. Ainsi, consentement éclairé est consolidé comme l’un des outils les plus puissants de protection et de crédibilité dans la recherche universitaire.
FAQ : Questions fréquemment posées
Qu’est-ce que le consentement éclairé dans la pratique ?
En effet, le consentement éclairé est le processus par lequel le chercheur explique les objectifs, les risques, les avantages et les procédures d’une étude de recherche, garantissant ainsi que le participant peut décider librement de sa participation.
Comment garantir la confidentialité des données dans la recherche qualitative ?
Afin de garantir la confidentialité, des protocoles de sécurité sont adoptés (cryptage, stockage sécurisé) et sélectionnés logiciel d'analyse de données qualitatives fiable, comme requalifier.ai, qui offrent une protection et un contrôle d'accès.
Quand dois-je mettre à jour mon consentement éclairé ?
Chaque fois que des changements substantiels surviennent dans l'étude, tels que de nouveaux risques, de nouvelles méthodes ou des modifications de calendrier, il est nécessaire d'informer les participants et d'évaluer si un nouveau formulaire de consentement est nécessaire.
Quelles précautions dois-je prendre dans différents contextes culturels ?
Adapter le langage, les exemples et les méthodes de collecte de données aux circonstances locales. L'intervention de médiateurs culturels peut être essentielle pour garantir la compréhension du consentement dans les régions où les langues sont minoritaires ou où les coutumes sont spécifiques.
Est-il suffisant de remettre un document à signer aux participants ?
Non. L'idéal est de favoriser le dialogue et la clarification. La signature formalise le processus, mais la véritable compréhension passe par un échange d'informations transparent et accessible.
Puis-je réutiliser les données d’une enquête pour une autre étude ?
En général, cela dépendra de ce qui a été convenu dans le consentement initial. Si la réutilisation implique de nouvelles finalités ou méthodes, il est recommandé de renouveler le consentement, en garantissant la transparence et le respect de l'autonomie des participants.
Références bibliographiques
- Dickert, N. W., Eyal, N., Goldkind, S. F., Grady, C., Joffe, S., Lo, B., Miller, F. G., Pentz, R. D., Silbergleit, R., Weinfurt, K. P., Wendler, D., et Kim, SYH (2017). Recadrer le consentement pour la recherche clinique : une approche fonctionnelle. La revue américaine de bioéthique : AJOB, 17(12), 3–11. https://doi.org/10.1080/15265161.2017.1388448
- Frost, C.J., Johnson, E.P., Witte, B., Stark, L., Botkin, J., & Rothwell, E. (2021). Informations électroniques sur le consentement éclairé pour la recherche sur les échantillons résiduels de nouveau-nés : résultats de groupes de discussion avec des populations diverses. Journal de génétique communautaire, 12(1), 199–203. https://doi.org/10.1007/s12687-020-00496-y
- Gelinas, L., Wertheimer, A., et Miller, F. G. (2016). Quand et pourquoi la recherche sans consentement est-elle autorisée ? Le rapport du Hastings Center, 46(2), 35–43. https://doi.org/10.1002/hast.548
- Grady, C., Cummings, S. R., Rowbotham, M. C., McConnell, M. V., Ashley, E. A., et Kang, G. (2017). Consentement éclairé. Le New England Journal of Medicine, 376(9), 856-867. http://DOI: 10.1056/NEJMra1603773
- Hake, AM, Dacks, PA, Arnerić, SP et groupe de travail CAMD ICF (2017). Un consentement éclairé concis pour accroître l'accès aux données et aux échantillons biologiques pourrait accélérer les traitements innovants de la maladie d'Alzheimer. Maladie d'Alzheimer et démence (New York, NY), 3(4), 536–541. https://doi.org/10.1016/j.trci.2017.08.003
- Riden, HE, Grooms, KN, Clark, CR, Cohen, LR, Gagne, J., Tovar, DA, Ommerborn, MJ, Orton, PS, & Johnson, PA (2012). Leçons apprises sur l'obtention du consentement éclairé dans la recherche auprès des populations vulnérables en milieu hospitalier. Notes de recherche du BMC, 5, 624. https://doi.org/10.1186/1756-0500-5-624
- Xu, A., Baysari, MT, Stocker, SL, Leow, LJ, Day, RO et Carland, JE (2020). Points de vue et expériences des chercheurs sur l’obligation d’obtenir un consentement éclairé dans le cadre de recherches impliquant des participants humains : une étude qualitative. Éthique médicale du BMC, 21(1), 93. https://doi.org/10.1186/s12910-020-00538-7