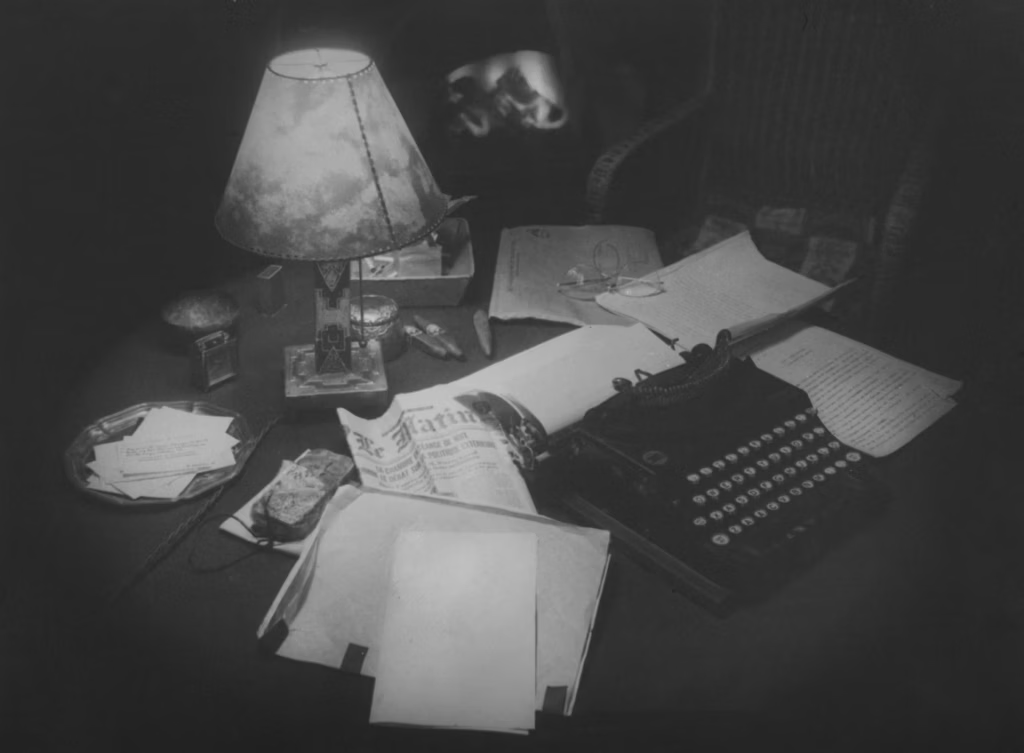
Résumé: LE recherche narrative La recherche narrative se caractérise par la collecte, l'analyse et l'interprétation d'histoires et d'expériences individuelles, mettant en lumière la manière dont chaque sujet construit des sens et des significations (Johnson, 2017 ; Stejskalová et Štrach, 2015). Plutôt que de se limiter aux données quantitatives, cette approche explore les aspects subjectifs, donnant la parole à différentes réalités et favorisant les réflexions sur la culture, la société et l'identité (McAleese et Kilty, 2019). Dans cet article, nous explorons les définitions de la recherche narrative, ses méthodes, ses questions critiques, ses implications éthiques et sociales, et analysons sa pertinence actuelle et ses implications futures pour recherche qualitative dans le contexte académique. Nous examinons également le rôle des technologies telles que requalifier.ai, Nvivo, Atlas.ti, MaxQDA et Iramuteq pour faciliter le processus d’analyse des récits, notamment dans le contexte de l’analyse de données qualitatives.
Introduction
Au histoires Les histoires que nous racontons ou entendons façonnent notre perception du monde et influencent nos relations avec les autres. Mais pourquoi certains récits ont-ils un tel pouvoir de dépeindre des réalités complexes, tandis que d'autres sont minimisés ou ignorés ? recherche narrative cherche précisément à donner de la visibilité aux manières dont les individus vivent et rapportent leurs expériences, révélant les multiples significations culturelles, sociales et historiques qui imprègnent chaque histoire.
À partir des années 1980, la recherche narrative a pris de l'ampleur en sciences sociales, ouvrant la voie à une approche plus sensible de l'étude des réalités subjectives. Depuis, elle est devenue une approche fondamentale des études qualitatives, offrant une profondeur interprétative et laissant place à des voix jusque-là tues (Johnson et Rasulova, 2017). Actuellement, avec le soutien de logiciel d'analyse de données qualitatives et même des solutions recherche qualitative avec IA, comme le requalifier.ai, ce processus devient plus dynamique et plus complet.
Cet article montre comment la recherche narrative offre au chercheur une nouvelle perspective sur construction du sens et les influences contextuelles sur l'acte narratif. Nous espérons qu'à la fin de cette lecture, vous comprendrez l'importance de donner la parole à des histoires personnelles, en les adoptant comme une source précieuse pour comprendre les expériences humaines.
Qu'est-ce que la recherche narrative ?
Concepts et définitions
LE recherche narrative étudie la manière dont les individus et les groupes organisent et transmettent leurs expériences sous forme de récits. Cette approche ne se limite pas à la collecte de témoignages ; elle vise à comprendre le processus de narration, c'est-à-dire la structure et le contexte dans lesquels les histoires sont produites, ainsi que les identités qui en émergent (Loh, 2013 ; McAleese et Kilty, 2019). Les termes associés incluent :
- Analyse narrative : Se concentre sur la façon dont l’histoire est construite, en examinant les modèles d’intrigue, les personnages et les thèmes (Treloar et al., 2014).
- Enquête narrative : Il met l’accent sur la co-construction de significations dans le dialogue entre le participant et le chercheur, en explorant non seulement l’histoire, mais aussi la dynamique qui la produit (Juntunen & Lehenkari, 2019).
- Raconter des histoires : Il englobe l’acte intuitif de raconter des expériences, de relier des événements passés, présents et futurs d’un point de vue culturel et historique (McAleese & Kilty, 2019).
Ces définitions complémentaires nous aident à comprendre que le récit n’est pas seulement une forme de communication, mais un élément essentiel de la construction de l’identité et de la façon dont nous comprenons le monde (Byrne, 2016).
Importance du contexte
Dans la recherche narrative, le contexte est aussi importante que l'histoire elle-même (Stejskalová et Štrach, 2015). Des facteurs tels que la classe sociale, le genre, l'origine ethnique, la situation géographique et les expériences personnelles façonnent la manière dont chaque personne raconte et interprète son expérience. Par conséquent, les analyses qui ignorent ces variables peuvent entraîner des distorsions ou des simplifications excessives. Ainsi, l'attention portée au contexte enrichit l'interprétation, offrant de multiples niveaux de signification à chaque récit.
Questions importantes dans la recherche narrative
Principalement, le recherche narrative Il soulève une série de questions qui aident à définir l'objet de l'étude et la méthode adoptée. En voici quelques-unes :
- Comment les récits personnels révèlent-ils des modèles culturels ?
En général, les histoires rapportées peuvent mettre en évidence des normes sociales, culturelles et idéologiques souvent négligées par des perspectives purement quantitatives (Greenhalgh et al., 2005). - Quel est le rôle du dialogue dans la création de sens ?
L’interaction entre l’intervieweur et l’interviewé est cruciale pour co-construction des significations, influençant la manière dont les thèmes sont explorés (Johnson, 2017). - Comment la conception méthodologique impacte-t-elle l’analyse ?
Des méthodes structurées ou flexibles peuvent produire des résultats différents. Une conception claire mais sensible permet de recueillir des données qualitatives riches (McAleese et Kilty, 2019). - Quelle est la différence entre l’analyse narrative et l’investigation narrative ?
Alors que l’analyse narrative peut se concentrer sur la structure formelle de l’histoire, l’enquête narrative s’intéresse davantage à la compréhension de la manière dont le chercheur et le participant construisent collectivement le sens (Juntunen & Lehenkari, 2019). - Comment les récits influencent-ils les processus identitaires ?
Les histoires peuvent donner de la voix aux groupes marginalisés, contribuant à l’autonomisation et à la stimulation des transformations sociales (Stejskalová & Štrach, 2015).
Questions et erreurs fréquentes dans la recherche narrative
Séparation de l'expérience du chercheur
En général, la question de savoir s'il est approprié de maintenir une neutralité absolue du chercheur lors de l'analyse des récits est souvent posée. Par conséquent, ignorer l'influence mutuelle entre le chercheur et le participant conduit à des interprétations simplistes et constitue une erreur très courante (Byrne, 2016). Dans le contexte de recherche qualitative, il est essentiel de reconnaître que le chercheur apporte également ses propres expériences, valeurs et croyances à l’interprétation.
Normalisation des récits
Une autre question est de savoir comment respecter les particularités de chaque récit sans imposer un « modèle narratif ». Il est probable que les chercheurs, en imposant un format fixe aux récits, en dénaturent la richesse culturelle (Patterson, 2013). Par conséquent, la recherche narrative présuppose une certaine flexibilité, permettant à chaque participant de raconter son histoire de manière authentique.
Structuration de la recherche
Une autre question est de savoir quelle est la meilleure façon d'organiser une étude narrative. Dans ce sens, l'utilisation de modèles méthodologiques inappropriés ou une planification peu claire peuvent entraîner des informations disparates (Johnson et Rasulova, 2017). Il est essentiel de définir des objectifs et des stratégies de collecte et d'analyse cohérents avec la proposition narrative.
Méthodes d'analyse narrative et d'investigation narrative
Selon l’objectif de l’étude, le chercheur peut adopter différentes méthodes :
Analyse narrative
LE analyse narrative L'étude se concentre particulièrement sur la structure des récits. Des éléments tels que l'intrigue, les personnages, le décor et les points clés de l'intrigue sont examinés afin d'identifier des schémas et des thèmes récurrents (Treloar et al., 2014). Par exemple, dans une étude sur recherche qualitative avec IA, l'analyse narrative peut explorer la manière dont le participant raconte son expérience d'utilisation d'un outil comme requalifier.ai, en mettant en évidence les passages clés qui révèlent les attentes, les défis et les avantages perçus.
Enquête narrative
LE enquête narrative L'enquête narrative va au-delà de la structure du texte. Elle s'attache à comprendre comment le récit émerge de l'interaction entre le chercheur et le participant (Johnson, 2017). Dans cette approche, le chercheur reconnaît que l'acte même de poser des questions et d'écouter influence la forme et le contenu du récit. Par conséquent, l'enquête narrative met généralement l'accent sur la réflexivité, c'est-à-dire sur le rôle actif du chercheur dans la co-création des données (Juntunen et Lehenkari, 2019).
Les deux approches peuvent se compléter, selon les objectifs de l'étude. En général, recherche narrative Il est très flexible, permettant au chercheur de choisir les stratégies les plus adaptées à la question de recherche.
Le rôle de la narration dans la recherche narrative
Raconter des histoires est « l’âme » de recherche narrativeC'est par le récit que les sujets donnent du sens à leurs expériences, reliant passé, présent et futur dans un récit cohérent (McAleese et Kilty, 2019). Par exemple, lors d'entretiens avec des professionnels de la santé sur leurs expériences en première ligne de soins, le récit révèle des nuances émotionnelles et contextuelles difficiles à saisir par des questionnaires fermés (Greenhalgh et al., 2005).
De même, dans les recherches sur comment faire une analyse de données qualitatives, le récit du chercheur lui-même peut clarifier le raisonnement derrière le choix des méthodes, y compris l'utilisation de logiciel d'analyse de données qualitatives. Ainsi, partager les difficultés et les découvertes de ceux qui enquêtent enrichit la compréhension du processus.
Impact des récits sur la représentation des expériences individuelles et des politiques publiques
Les récits personnels sont pertinents non seulement dans le milieu universitaire, mais aussi dans les forums de politiques publiques et les mouvements sociaux. Lorsque les expériences individuelles sont mises en commun, elles peuvent mettre en lumière les lacunes des programmes gouvernementaux ou inspirer des changements institutionnels. Dans des secteurs comme la santé publique, l'éducation ou la justice, les récits personnels de la vie fournissent souvent des preuves qualitatives de l’endroit et des raisons pour lesquelles une politique échoue ou réussit (Stejskalová et Štrach, 2015).
De cette façon, le analyse de contenu et le codification Les récits personnels peuvent servir à cartographier les tensions sociales, à mettre en évidence des besoins non satisfaits ou à révéler des préjugés. Grâce à des outils tels que Nvivo, Atlas.ti, MaxQDA ou même des solutions plus simples comme Iramuteq, le chercheur peut organiser les informations de manière systématique, en extrayant des modèles significatifs qui peuvent ensuite soutenir des politiques inclusives.
Défis et opportunités de la recherche narrative
En général, les principaux défis sont :
- Collecte et analyse approfondies : Elles requièrent des compétences spécifiques d'écoute active et d'interprétation. Le chercheur doit être capable de gérer les ambiguïtés et les contradictions.
- Sensibilité et éthique : Comme les récits peuvent aborder des expériences sensibles, il est essentiel de maintenir la confidentialité et de respecter le participant (Byrne, 2016).
- Réflexivité : Éviter les projections et les jugements des chercheurs lors de l’interprétation des données nécessite une auto-réflexion constante (Johnson et Rasulova, 2017).
D'autre part, il existe quelques opportunités, à savoir :
- Intégration avec les technologies : L’utilisation de solutions telles que requalifier.ai, qui intègre des fonctionnalités de recherche qualitative avec IA, peut accélérer la transcription et l’analyse des récits audio ou vidéo, facilitant ainsi l’identification des thèmes émergents.
- Interdisciplinarité : La recherche narrative est adoptée dans différents domaines (administration, santé, éducation, sciences sociales), élargissant le potentiel de collaboration et d’échange de connaissances (Johnson, 2017).
- Génération de connaissances approfondies : Les histoires peuvent saisir des aspects subjectifs et culturels, offrant des perspectives qui vont au-delà de ce que la recherche quantitative isolée peut réaliser (McAleese & Kilty, 2019).
Contexte historique et pertinence actuelle
LE recherche narrative La théorie de la pensée a émergé avec force dans les années 1980, au cœur des courants postmodernes qui valorisaient la pluralité des voix et des subjectivités, négligées par le positivisme traditionnel (McAleese et Kilty, 2019). Depuis, elle s'est imposée comme une méthode alternative d'investigation. « comment les gens perçoivent le monde ».
Aujourd'hui, avec l'essor des technologies d'enregistrement et de traitement des données qualitatives, ainsi que l'intérêt croissant pour les méthodes participatives, la recherche narrative s'avère de plus en plus pertinente (Holmlund et al., 2019). Au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine en particulier, cette approche occupe une place prépondérante dans la recherche communautaire, donnant la parole aux minorités ethniques, aux groupes autochtones et aux mouvements sociaux.
Implications futures de la recherche narrative
Intégration avec les technologies numériques et l'IA
Outils analyse de données qualitatives évolué pour gérer de grands volumes d'informations et effectuer codification automatique ou semi-automatique. Des logiciels tels que Atlas.ti, MaxQDA, Nvivo et requalifier.ai permettent de rationaliser les processus manuels, en offrant des capacités de recherche par mots-clés, de cartographie des catégories et même d'analyse des sentiments, lorsqu'ils sont combinés avec des algorithmes d'IA (Treloar et al., 2014).
Cette intégration technologique profite à la recherche narrative En réduisant le temps consacré aux tâches répétitives et en permettant une meilleure concentration sur l'interprétation. De plus, l'IA peut aider à identifier les structures narratives récurrentes, révélant des liens qui pourraient autrement passer inaperçus lors d'analyses purement manuelles.
Développement d'approches éthiques
La vitesse technologique ne doit pas se faire au détriment de éthique. Dans la mesure où logiciel d'IA Lorsqu'il traite des données sensibles et des récits personnels, le chercheur doit garantir la transparence du consentement et la sécurité du stockage des informations (Stejskalová et Štrach, 2015). Cela exige une position éthique rigoureuse, tenant compte des risques potentiels d'exposition et de la nécessité de protéger la vie privée des participants, en particulier dans les récits abordant des traumatismes ou des questions identitaires sensibles.
Conseils pratiques pour une recherche narrative efficace
- Définir l’objectif : Clarifiez l'objectif principal de votre enquête. À quelle question souhaitez-vous répondre en recueillant des récits ?
- Investissez dans des entretiens ouverts : Posez des questions générales qui encouragent les participants à raconter librement leur histoire. Évitez les questions qui induisent des réponses préformatées.
- Maintenir une attitude éthique : Expliquez aux participants comment leurs données seront utilisées et assurez leur confidentialité. Dans les études comportant de grandes quantités de données, utilisez des plateformes sécurisées telles que requalifier.ai peut aider.
- Utiliser les outils numériques : Des logiciels comme Nvivo, Atlas.ti, MaxQDA et Iramuteq peut optimiser la codification et l'organisation des données. Cela rend l'analyse plus systématique et plus rapide.
- Explorez des études de cas et des exemples pratiques : Les histoires concrètes illustrent le potentiel et les limites de la recherche narrative, permettant des réflexions méthodologiques plus riches.
Conclusion
LE recherche narrative Cette approche s'impose comme fondamentale pour ceux qui souhaitent dépasser la simple collecte de statistiques et approfondir les particularités et les nuances de l'expérience humaine. En donnant la parole aux participants, elle permet de comprendre comment les individus construisent du sens, établissent des identités et interagissent avec leur contexte social et culturel (Loh, 2013 ; Johnson, 2017).
Dans un scénario marqué par une complexité sociale croissante, récits deviennent des passerelles pour comprendre des phénomènes qui échappent aux méthodologies quantitatives (Kilty, 2019). Parallèlement, les progrès technologiques recherche qualitative avec IA et des outils comme requalifier.ai permet de traiter de grands volumes de données, sans perdre de vue la profondeur et la sensibilité qui caractérisent les récits. Le résultat est un approche hybride, alliant rigueur académique et capacité à saisir les significations complexes qui émergent des histoires personnelles.
Dans cette perspective, la recherche narrative Non seulement elle s'impose comme une stratégie méthodologique pertinente, mais elle constitue également une ressource éthique et politique permettant de donner la parole aux individus et aux groupes, notamment à ceux qui sont parfois réduits au silence ou rendus invisibles. S'immerger dans la richesse des récits peut guider des politiques publiques plus inclusives, tout en élargissant les horizons du champ académique, en générant des connaissances intégrant la multiplicité des expériences humaines.
FAQ : Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que la recherche narrative ?
Il s'agit d'une approche méthodologique qui étudie la manière dont les individus et les groupes organisent et donnent du sens à leurs expériences à travers des récits. En recueillant ces récits, nous cherchons à comprendre non seulement leur contenu, mais aussi le processus de construction narrative.
Quelle est la différence entre l’analyse narrative et l’enquête narrative ?
L’analyse narrative se concentre sur la structure et les éléments des histoires (intrigue, personnages, thèmes), tandis que l’enquête narrative met l’accent sur la co-construction du sens dans l’interaction entre le chercheur et le participant.
Comment des logiciels comme requalify.ai, Nvivo et Atlas.ti aident-ils à la recherche narrative ?
Ces outils simplifient la transcription, le codage et l'analyse des données qualitatives. En particulier, requalifier.ai peut utiliser l’IA pour organiser et interpréter de grands volumes de rapports plus efficacement, permettant au chercheur de se concentrer sur la profondeur de l’interprétation.
Est-il possible de maintenir la neutralité du chercheur dans la recherche narrative ?
Pas entièrement. Dans la plupart des approches qualitatives, il est reconnu que le chercheur influence et est influencé par le processus de collecte et d'analyse, et il est essentiel d'adopter une attitude réflexive pour gérer cette interaction.
Quelles précautions éthiques dois-je prendre dans la recherche narrative ?
Il est crucial d'obtenir un consentement éclairé, de garantir la confidentialité et de respecter la sensibilité des sujets abordés. Dans les récits portant sur des sujets sensibles, la prudence éthique doit être redoublée afin d'éviter toute exposition excessive des participants.
Pourquoi la recherche narrative est-elle pertinente pour les politiques publiques ?
Les récits personnels peuvent mettre en lumière des lacunes et des problèmes qui n'apparaissent pas dans les données statistiques. Ainsi, les résultats de la recherche narrative peuvent favoriser des décisions et des actions plus inclusives et plus efficaces en matière de politiques publiques.
Références bibliographiques
- Byrne, J. A. (2016). Améliorer l'évaluation par les pairs des revues de littérature narrative. Révision par les pairs Res Integr 1(12): 1-4. https://doi.org/10.1186/s41073-016-0019-2
- Greenhalgh, T., Russell, J. et Swinglehurst, D. (2005). Méthodes narratives dans la recherche sur l'amélioration de la qualité. Qualité et sécurité des soins de santé, 14(6), 443–449. https://doi.org/10.1136/qshc.2005.014712
- Holmlund, M., Witell, L. et Gustafsson, A. (2019). Point de vue : faire publier votre recherche qualitative sur les services. Journal du marketing des services, 34(1): 111-116. https://doi.org/10.1108/JSM-11-2019-0444
- Johnson, S., et Rasulova, S. (2017). Recherche qualitative et évaluation de l'impact sur le développement : intégrer l'authenticité dans l'évaluation de la rigueur. Journal de l'efficacité du développement, 9(2), 263–276. https://doi.org/10.1080/19439342.2017.1306577
- Juntunen, M., et Lehenkari, M. (2019). Un processus de revue de littérature narrative pour une thèse de recherche universitaire en commerce. Études dans l'enseignement supérieur, 46(2), 330-342. https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1630813
- McAleese, S. et Kilty, JM (2019). Les histoires comptent : réaffirmer la valeur de la recherche qualitative. Le rapport qualitatif, 24(4), 822-845. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.3713
- Loh, J. (2013). Enquête sur les questions de fiabilité et de qualité dans les études narratives : une perspective. Le rapport qualitatif, 18(33), 1-15. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2013.1477
- Stejskalová, I., et Štrach, P. (2015). Recueillir des données de recherche à l'ère de l'information : recherche qualitative par analyse narrative. Articles du SSRN. XIVe Conférence internationale sur les affaires et l'économie Bangkok, Thaïlande, 5-8 janvier 2015. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2550715
- Treloar, A., Stone, T.E., McMillan, M., et Flakus, K. (2014). Un récit en quête d'une méthodologie. Psychologie, édition et communication. https://doi.org/10.1111/ppc.12081


